N° 4 – La Bête de l'événement
Nouvelle série – 2024 – 100 pages – éditions Sprezzatura – 10 €
Sommaire
- ÉditorialCollectif
- Une tête de Janus : SollersFrançois Meyronnis
- De la cybernétique comme messe noireSandrick Le Maguer
- Le CerveauNorbert Wiener
- Les Signes du MessieAnonyme
- Dans l'abîmeFrançois Meyronnis
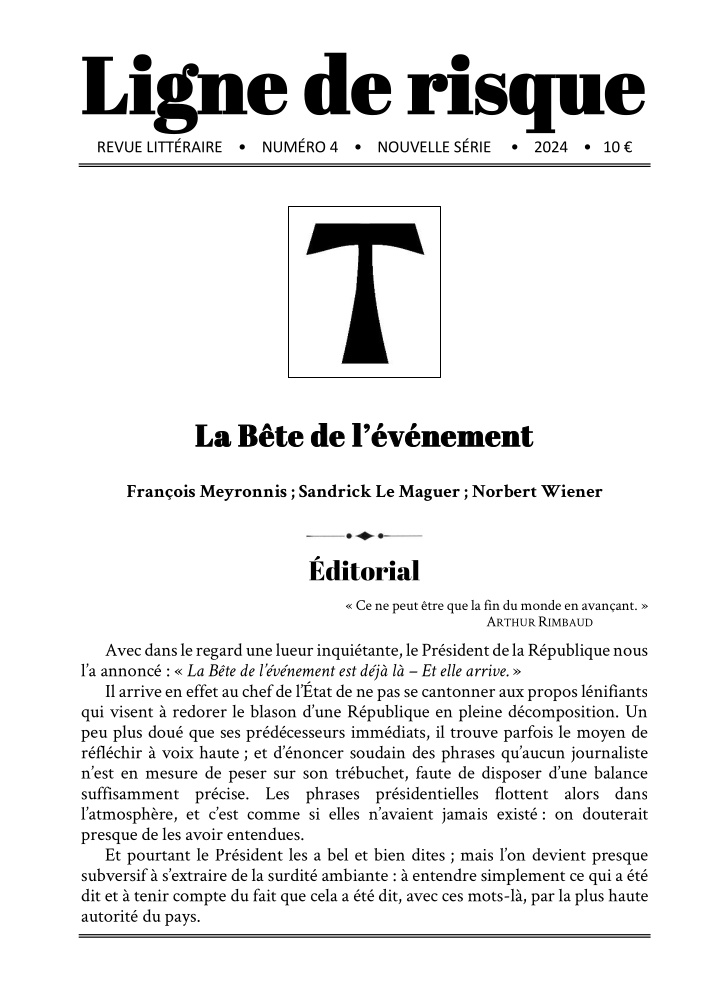
Éditorial
François Meyronnis & Sandrick Le Maguer
« Ce ne peut être que la fin du monde en avançant. »
Arthur Rimbaud
Avec dans le regard une lueur inquiétante, le Président de la République nous l’a annoncé : « La Bête de l’événement est déjà là – Et elle arrive. »
Il arrive en effet au chef de l’État de ne pas se cantonner aux propos lénifiants qui visent à redorer le blason d’une République en pleine décomposition. Un peu plus doué que ses prédécesseurs immédiats, il trouve parfois le moyen de réfléchir à voix haute ; et d’énoncer soudain des phrases qu’aucun journaliste n’est en mesure de peser sur son trébuchet, faute de disposer d’une balance suffisamment précise. Les phrases présidentielles flottent alors dans l’atmosphère, et c’est comme si elles n’avaient jamais existé : on douterait presque de les avoir entendues.
Et pourtant le Président les a bel et bien dites ; mais l’on devient presque subversif à s’extraire de la surdité ambiante : à entendre simplement ce qui a été dit et à tenir compte du fait que cela a été dit, avec ces mots-là, par la plus haute autorité du pays.
Ainsi donc la « Bête de l’événement » aurait déjà surgi, et elle approcherait de nous à notre insu.
Mais que signifie cette annonce ? Admettons un instant qu’il ne s’agisse pas d’une vulgaire concession au pittoresque apocalyptique, encore moins d’une trouvaille vide ; mais d’un énoncé où affleure une clairvoyance pleine d’audace. Admettons en effet qu’avec cette « Bête de l’événement » nous soyons confrontés à une urgence eschatologique. Alors, oublions le Président et ses intentions éventuelles quand il prononce cette formule remplie de mystère, et ne nous demandons pas si elle témoigne chez lui du frémissement d’une intelligence. De toute façon, cet homme ne nous a habitués à rien de tel. Sur le plan du discours, à part quelques traits inattendus ici ou là, il ne se recommande pour l’essentiel que par des laïus solennels et plâtreux, marqués au sceau d’une éloquence aussi creuse qu’emphatique.
Inutile, donc, de s’enquérir du fantoche officiel. En revanche, accordons toute notre attention à sa formule – prenant à cœur de saisir ce dont elle parle.
Sous le nom de « Bête de l’événement », on reconnaîtra d’abord la dissolution de la prétendue « réalité » dans le flux des agencements réticulaires. Alors que la plupart des intellectuels d’élevage se cramponnent au moment sociologique – quand la société, au xixe siècle, prenait la place de Dieu –, nous sommes depuis quarante ans passés dans une autre flexion du temps : car l’ère des algorithmes nous engouffre dans le moment cybernétique, où tout ce qui est appréhendable par nous se mue, par une inversion spectaculaire, en son dédoublement numérique, au point de devenir un simple tour de la virtualité.
À ce stade, comment ne pas voir l’indiscutable préséance du virtuel, que l’on peut constater dans tous les domaines, mais au premier chef en économie ? Et surtout, comment ne pas voir en elle une modalité de l’anéantissement ?
Il y aurait donc un lien entre les deux grands bouleversements du xxe siècle. Premier bouleversement : la mise en joue atomique à tout moment de l’espèce parlante, et cela depuis les attaques nucléaires des 6 et 9 août 1945. Second bouleversement : l’emprise cybernétique sur l’ensemble des êtres et des choses de sorte que le doublon numérique acquiert sur l’original une irrésistible suprématie.
Impossible, dès lors, de penser la bombe de Hiroshima et de Nagasaki, celle qui résulte du projet Manhattan, sans la mettre en rapport avec l’autre bombe, dont la cybernétique est le nom. D’autant qu’à propos de ces deux phénomènes collatéraux et germains, la bombe de Robert Oppenheimer et celle de Norbert Wiener, nous affirmons ici qu’ils entretiennent à leur tour un rapport de parenté avec la tentative d’extermination des juifs – avec ce qu’on a pris l’habitude d’appeler la Shoah. Et si l’on s’efforce dans cette livraison de mettre au jour le nœud infernal qui relie entre elles Bombe atomique, Bombe informatique et Extermination, c’est avant tout pour caractériser le lieu dans lequel, vaille que vaille, nous séjournons au xxie siècle.
Or ce lieu invivable, qu’il est très difficile de prendre en vue, nous disons qu’il relève de l’abîme. Et qu’il ne se laisse pas saisir sans un face-à-face avec la Bête de l’événement.
Afin de mieux comprendre ce qu’implique ce face-à-face nous revenons ici sur ce qui s’est réellement passé au siècle dernier, en le confrontant aussi bien aux textes de la sagesse d’Israël (dont le christianisme est une branche) qu’à la pensée des grands scientifiques, à commencer par celle de Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique.
Nous publions dans ce numéro une apocalypse issue de la tradition juive et une nouvelle traduite en français de Norbert Wiener lui-même. La qualité littéraire de celle-ci n’est peut-être pas ce qui la destine à l’attention de nos lecteurs ; en revanche, le texte est révélateur : il raconte comment, à travers une opération de neurochirurgie, on lobotomise le cerveau d’un homme. Et comment on prive ainsi cet homme, au demeurant mauvais, de toute pensée stratégique. La science, insiste souvent Wiener, a tendance à soumettre l’humanité à une forme de « vivisection ». Elle observe, mutile, découpe. Dans une lettre datée du 5 octobre 1953, Wiener écrit : « Nous dirigeons notre couteau directement sur le cerveau. Une forme de lobotomie frontale, au moyen d’une épingle, est devenue une procédure courante chez les psychiatres, et ce manque de respect pour l’intégrité du cerveau à l’égard de ceux que la société considère comme inadaptés n’est que l’extension grotesque d’une politique qui nourrit les scientifiques d’un demi-savoir de façon à en faire les agents serviles du dessein formulé par nos véritables héros, les businessmen, et les menace de toutes les peines s’ils ont la présomption de réfléchir à la nature et aux conséquences des politiques destructrices qu’on leur demande de mettre en place. »
Ainsi la Bête de l’événement se dévoile-t-elle, avec ses sept têtes et ses dix cornes, comme dit l’Apocalypse de saint Jean, à travers la science de l’atome et celle des algorithmes. Mais elle se manifeste également dans la succession des guerres et des épidémies qui sévissent actuellement sur la planète.
Fin 2019 – Irruption dans nos existences du virus couronné et du torrent d’insanité qui lui a fait cortège. Nous avons consacré toute la précédente livraison à cette jean-foutrerie, au risque d’achever notre ruine sociale. Mais comme le monde ne veut pas « supputer ses affres », selon la formule d’Antonin Artaud ; et que même « il a toujours fait tous les crimes […] pour n’avoir pas à entrer dans l’affre », il a choisi délibérément la fuite en avant, résolu à consolider le pot-au-noir dans lequel on nous force de naviguer.
Février 2022 – Défaite du virus couronné après deux ans et demi de règne. Non devant le vaccin – comme le voudrait la propagande – mais devant les troupes de la petite brute de Moscou envahissant l’Ukraine. Une nouvelle fois Russes et Américains sont aux prises, s’entendant pour faire tournoyer la mort au-dessus des « terres de sang ». Mais qui se soucie vraiment de cet étrange pays dont le nom désigne la frontière ? D’ailleurs est-ce une réalité de ce monde ? Franchement, on dirait plutôt que la démarcation passe, en ces parages, entre ceux qui se croient vivants et les fantômes.
Il y a bien sûr Holodomor, l’abjecte famine orchestrée par Staline dans les années 30 du xxe siècle, occasionnant le décès de millions d’Ukrainiens – le plus souvent des paysans. Tout le pays était devenu, selon l’historien Timothy Snyder, un « camp d’affamement géant », où les êtres se traînaient, exsangues, avant de s’écrouler d’inanition ; où les enfants, couverts de croûtes, avaient le ventre ballonné, et mouraient sans faire de bruit ; où des malheureux s’abandonnaient au cannibalisme, non sans honte, dans le seul espoir de survivre. Et tout cela tandis que les chancelleries occidentales conservaient un silence feutré, et que les meneurs progressistes, de même que les prétendus intellectuels, se vautraient dans une complicité tout simplement lamentable.
Il y a ensuite la Shoah par balles – le massacre des communautés juives par les nazis à l’été 1941, dans le cadre d’une grande politique d’extermination ; une « guerre contre les juifs », comme le disait sans ambages Hitler. Sans parler des nombreux pogroms des trois derniers siècles ; avec comme acmé les déferlements cosaques de 1648, laissant derrière eux des centaines et des centaines de milliers de victimes sur la terre d’Ukraine.
À ce propos, n’est-il pas curieux que les trois champions du patriotisme ukrainien, Bogdan Chmielnitsky, Simon Petlioura et Stepan Bandera, soient tous des grands pogromistes ? Peut-on faire crédit à un patriotisme adossé historiquement au massacre ? Même si le néo-stalinisme en vigueur à Moscou s’appuie en effet sur le truquage et le mensonge, comment lui préférer un nationalisme de pacotille entre les mains des stratèges états-uniens, non moins truqueurs, non moins mensongers que les séides de Poutine ; et, à cause de cela, non moins infernaux ?
7 octobre 2023 – Les projecteurs de l’actualité se détournent de l’Ukraine pour s’établir au Proche Orient. En une journée décisive les forces spéciales du Hamas réalisent, depuis Gaza, un gigantesque pogrom à l’intérieur de l’État d’Israël ; et cela à l’occasion d’une fête célébrant la donation de la Torah à son peuple par le Saint béni soit-Il.
Un piège diabolique, cette attaque ; et dans lequel Israël pouvait difficilement ne pas tomber. Comment les inévitables représailles exercées par Tsahal sur le territoire palestinien n’auraient-elles pas suscité dans le monde une énorme vague de réprobation ? Contre l’État d’Israël et son armée, cela va de soi ; mais aussi, de manière encore plus injuste, contre l’ensemble des juifs de la diaspora.
Avec un cynisme abject, les stratèges du Hamas ont anticipé les bombardements qui ensevelissent sous les gravats la ville de Gaza, avec le flot des victimes civiles où se débattent pêle-mêle hommes, femmes et enfants, dont les médias planétaires étalent chaque jour les souffrances à la une de leurs reportages. Relayée d’un bout à l’autre du globe par les soutiens de la cause palestinienne, la propagande du Hamas excite partout la haine à l’encontre du nom juif et avive la vieille rancune sur tous les continents. La vérité oblige à dire qu’elle est souvent secondée par les éléments extrémistes du sionisme, qui surenchérissent quotidiennement dans l’outrance ; mais aussi par l’absence de cap du gouvernement israélien, et son incapacité à fixer des perspectives crédibles pour l’avenir.
Mais la politique internationale ne nous intéresse pas en tant que telle : nous la laissons aux géopoliticiens. Ce qui pique notre curiosité, en revanche, c’est que l’intitulé de l’opération du 7 octobre contre Israël comporte le mot « déluge » ; et que le passage de la Torah étudié en ce jour dans les synagogues aborde précisément le déluge. Il y a plus, cependant : ce qui apparaît véritablement stupéfiant, c’est de quoi traite la section de lecture correspondant à l’attaque.
Voilà ce que raconte cette section, qui se trouve au sixième chapitre de la Genèse – Dieu, horrifié par la méchanceté humaine, se repend de la création. Il se résout à effacer les hommes de la surface de la Terre ; et, avec eux, les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel. Parmi ses contemporains, seul Noé est un homme juste – un tsadiq, en hébreu ; sinon, la Terre déborde de violence ; et, à cause de cette violence, Dieu décide de faire disparaître l’humanité, à l’exception de Noé et de sa famille.
Or quel terme hébraïque le mot « violence » traduit-il ? À prendre le texte original, on découvre que c’est le terme – Hamas (het-mem-samekh), qui signifie en hébreu : « faire violence » ; « nuire » ; « violer » ; « détruire ».
Aussi est-ce à cause du hamas que le Saint béni soit-Il se résigne à anéantir sa propre création ; l’extraordinaire étant justement que le mot surgisse deux fois dans la section de lecture à méditer le 7 octobre.
Même si les intellectuels d’élevage ne s’en doutent pas, nous sommes devant l’abîme. Le monde lui-même, déjà pris dans un courant tourbillonnaire, penche au bord du précipice.
Pour un écrivain, une seule question pertinente : quelle parole tiendrait le coup par rapport à ce gouffre ? Évidemment pas celle de la petite bourgeoisie intellectuelle, qui verse chaque jour davantage dans l’insignifiance. D’ailleurs à l’exception d’une tapée d’imbéciles, on ne reconnaît plus ce vieux discours et on n’en fait plus usage. Même s’il demeure propagé dans les médias officiels, il n’a plus cours. Quant aux pauvres scribouillards, empêtrés dans leur subjectivisme rabougri, ils se laissent balayer entre deux pleurnicheries, incapables qu’ils sont de brûler sur leur cuillère, comme dirait Isidore Ducasse, le « canard du doute, aux lèvres de vermouth ». Laissez-les donc s’accroupir aux étalages des libraires : leur vocation, depuis la crise covidienne, est de s’effacer, avant même d’y prendre place, dans la mémoire des contemporains.
Mais un petit nombre, pour lequel le virus couronné n’a pas été une occasion de chute, refuse qu’on lui alloue comme sort unique l’évacuation. Alors qu’on fait comprendre à chacun qu’il n’est pas la colombe cherchée, aucun d’entre eux ne se vexe, puisqu’en général l’estime de cinq personnes, mettons six, leur suffit : et qu’ils sont même si peu présomptueux que l’idée d’être connus par les gens qui viendront quand ils n’y seront plus les amuse, et même les honore.
Si quelqu’un faisait partie de ce petit nombre, c’était notre ami Philippe Sollers, qui a été l’une des figures de cette revue. Personne n’échappait comme lui aux conditionnements de l’époque. Nous pouvons témoigner qu’il ne croyait absolument pas à la société ; seulement à la puissance de la parole, et à la possibilité d’être sauvé par elle – de rejoindre par elle le commencement, en dehors de toute psychologie et de toute morale.
Sans doute prenait-il soin, parfois, de se rendre acceptable : un minimum de reconnaissance lui semblant nécessaire. Ce qui impliquait, dans certains cas, le recours au malentendu.
Au fond, Sollers aurait voulu être un saint ; et, d’une certaine manière, il l’a été, même si cet énoncé paraîtra délirant à beaucoup. Attaché à la dimension intérieure du langage, il aimait et défendait tous les noms de la littérature. Plus précisément, tous ceux qui ont trouvé la « clé de l’amour » et en qui la parole a atteint une fulguration illuminante. Rien d’autre n’avait de prix à ses yeux – « l’espèce – disait-il – est une trappe dont j’essaye en gros de sortir ».
Notre ami n’était pas un humaniste – Ce n’était donc pas une « Grande-Tête-Molle », pour parler comme Isidore Ducasse, comte de Lautréamont.
Il appréciait des auteurs aussi paradoxaux que Joseph de Maistre ; et surtout il croyait qu’on pouvait, dès aujourd’hui, être avec la parole dans le paradis – vraiment aujourd’hui.
Nous republions ici un texte servant de préface au volume Poker, édité par Gallimard en 2005. On n’en a pas changé un seul mot.